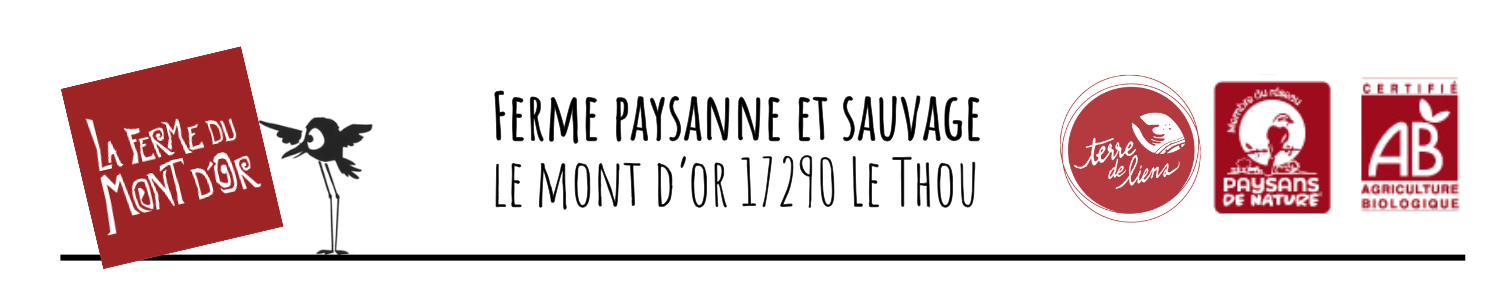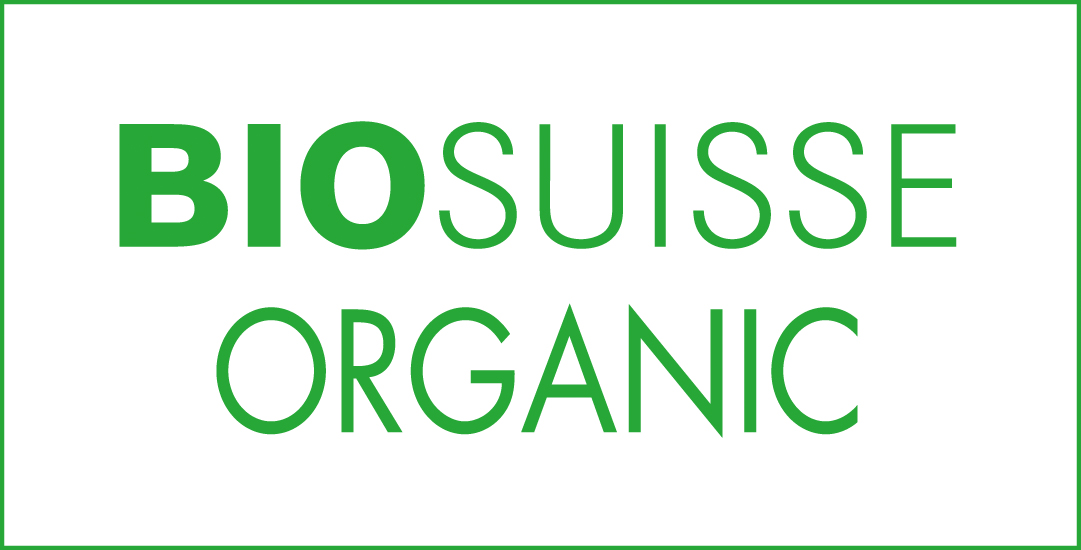Travailler à plusieurs… y-a-t-il une recette magique ?

Je suis venue en stage au Mont d’Or pour découvrir le travail de céréalier tout au long de l’année et pour approfondir mes connaissances en boulangerie. Après huit semaines passées avec les trois associés de la ferme, je repars remplie d’une nouvelle expérience, mais aussi avec de nombreuses questions sur la suite de mon projet notamment sur le travail à plusieurs et la place de chacun dans une histoire collective.
Ce que je connaissais du Mont d’Or avant d’y venir… ferme céréalière en agriculture biologique de 95 hectares, une partie de la production vendue en coopérative et l’autre partie transformée en farine puis en pain, et vente en sachets de farines et légumes secs. GAEC de trois personnes : Stéphanie qui s’occupe de la boulangerie, Emmanuel, son frère, responsable des cultures et Cédric, son mari, référent meunerie. Une volonté commune d’aller plus loin que les normes demandées par le label AB en réfléchissant en profondeur au sens de leurs métiers et de leurs projets de vie. Cela passe entre autre par une production vouée exclusivement à de l’alimentation humaine, exceptée la luzerne, par la plantation de haies et le redécoupage des parcelles, par l’implantation d’arbres en agroforesterie, par la quasi-suppression de l’irrigation en grandes cultures, par la mise en possibilité de créer un jardin de cocagne sur quelques hectares de leurs terres… Voilà ce que je savais de cette ferme avant même d’y mettre les pieds. La couleur est déjà annoncée, l’éthique occupe une place importante dans leurs activités.
Chaque semaine commence par une réunion collective le lundi matin de 9h à midi. C’est le moment où chacun expose des points divers et variés, sur des décisions à prendre, des points à débattre, des informations à donner. C’est aussi le moment de faire le planning de la semaine, puisque même si chacun est référent d’un atelier, il est bon de savoir ce que les autres font dans la semaine et certaines tâches sont partagées comme la commercialisation. Puis le lundi après-midi arrive et là ça file tout droit jusqu’au vendredi soir. Le four commence sa première chauffe de la semaine le lundi soir, et continuera le mardi, mercredi et vendredi. Le moulin tourne encore et encore pour écraser grains de blé, de sarrasin ou d’épeautre (grand et petit !). Le tracteur, auquel on attèle charrue, herse ou semoir, avance doucement dans le champ pour effectuer la tâche nécessaire. Parfois il demande quelques réparations impromptues qui modifient le planning de la semaine. Et puis il y a le camion qui part livrer les restaurants scolaires, les AMAP, les magasins… sans oublier l’ordinateur qui permet de gérer un peu toute cette entreprise via le contrôle de la facturation, de la trésorerie et toute autre tâche administrative nécessaire au bon déroulement.
Mais derrière tout ça il y a surtout trois associés qui travaillent et qui s’occupent de faire vivre cette ferme à leur image. Produire de façon qualitative, écologiquement responsable et humainement soutenable ça demande du temps et de l’énergie (humaine !). Et c’est là que le « humainement soutenable » est rediscuté. Quand la charge de travail devient un poids, il est important de ralentir et de se poser les bonnes questions. Dans la volonté de s’installer à plusieurs il y a entre autre l’idée de mutualiser les compétences, les énergies pour se libérer du temps afin de continuer à apprendre, à créer, à améliorer. Quand ce temps vient à manquer on ressent un certain vide et une perte de sens de notre activité. Au Mont d’Or il y a cette envie d’aller au-delà des difficultés et de trouver des solutions. Alors on prend le temps de discuter et d’imaginer d’autres issues. On repartage les temps de commercialisation, on modifie le fonctionnement des ventes, on ne s’arrête pas dans la création et on se lance dans un nouveau produit, avec la bière. Et puis pourquoi ne pas continuer l’aventure avec d’autres ? De nouvelles personnes ce sont de nouvelles énergies, de nouvelles idées, ça demande de se re-questionner sur qui on est et où l’on va. C’est aussi aller vers l’inconnu, prendre le risque de partager le quotidien avec des personnes que l’on ne connait pas ou peu, se dire que les décisions seront plus longues à prendre puisque on sera 4, 5, au lieu de 3… Comment fait-on pour sauter le pas ? A quel moment se dit-on, « c’est parti, on y va ensemble » ? C’est un peu comme le mariage finalement, on fait le pari d’y aller pour toute une vie (ou du moins on l’espère), mais qui nous dit que ça fonctionnera ? Le jeu en vaut-il la chandelle ? D’un autre côté, si on ne part jamais, on ne pourra pas aller au-delà de nos craintes, et peut-être passerons-nous à côté de beaux moments, de projets intéressants.
De ce que j’ai pu observer ou vivre ces dernières années, la partie humaine d’un projet est beaucoup plus intuitive et non prévisible que la partie économique ou organisationnelle… et pourtant elle en est la clé de réussite numéro un ! Alors comment fait-on ? Là je n’ai toujours pas la réponse. Un projet collectif prend forme avec des personnes qui un jour se rencontrent et veulent créer ensemble dans la même éthique. Si ce projet sort de terre, il perdure grâce à la communication que ces personnes ont entre elles, à l’écoute active qu’elles s’offrent et à leur volonté de changer les choses pour améliorer leur quotidien. Un jour peut-être une de ces personnes aura envie de changer de direction et d’aller construire ailleurs, mais le projet lui, pourra perdurer avec de nouvelles énergies, et chacun en sortira plus enrichi humainement.
Mathilde – stagiaire BPREA 2018-2019